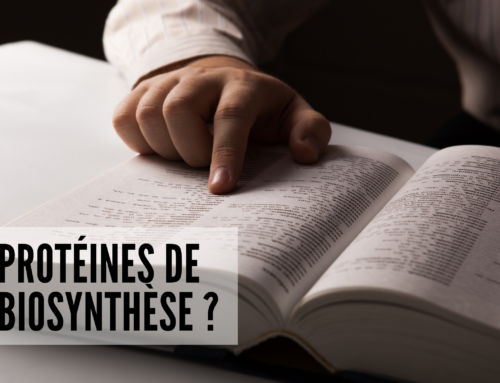La performance agricole doit-elle se réduire aux seuls rendements ?
L’agriculture actuelle, dite « moderne », est le fruit d’une évolution des modes de production (mécanisation, industrialisation, augmentation de la taille des exploitations, spécialisation, recours massif aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires), elle-même liée à une évolution des modes de consommations (consommation de masse, supermarchés, transformation des aliments consommés par l’agro-industrie, diminution du temps et du budget consacrés à l’alimentation et à la cuisine…).
Les différentes études et modèles proposés par les instituts de recherches et les agro-industriels ne prennent à l’heure actuelle en compte que des éléments quantitatifs basés sur le très court terme, à savoir les rendements. Le leitmotiv avancé est « il faut nourrir la planète ». Or, il est clair que d’une part la faim dans le monde n’a pas reculé avec l’apparition d’une agriculture productiviste, mais que nous arrivons à l’heure actuelle à des systèmes aberrants, où le soja OGM cultivé en Amérique du Sud fait le tour de la planète pour nourrir les vaches françaises, où l’on jette près de 30% de la nourriture produite, et où l’on constate une explosion des maladies dites de civilisation (diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers…) liés à la dégradation de la qualité de notre alimentation et de notre environnement. En parallèle de cela, le réchauffement climatique s’accroît et rend les populations encore plus vulnérables sur le plan alimentaire et sur la ressource eau.
Face à ces constats, il semble nécessaire de s’interroger sur notre modèle agricole, et plus précisément sur la quantification de sa performance. Le sacro-saint « rendement », utilisé depuis des décennies comme juge de paix pour évaluer une nouvelle variété de blé, un maïs génétiquement modifié pour résister aux herbicides, un modèle économique productiviste ou un nouvel engrais nous semble aujourd’hui à minima complètement obsolète, voire un moyen puissant de désinformation pour maintenir en place un modèle dont les intérêts sont ceux de grands groupes agro-industriels aux dépens des agriculteurs, des consommateurs et de notre planète.
Semer pour traiter
Première illustration avec la sélection et la mise sur le marché des semences. Pour être mise sur le marché, une graine doit être inscrite sur un catalogue officiel et faire la preuve de sa « qualité » selon 3 critères : l’homogénéité, la distinction et la stabilité. Des critères comme la richesse micro nutritionnelle (oligoéléments, minéraux, vitamines, oméga…) ne sont pas pris en compte, de même que par exemple la capacité à être économe en eau ou en intrants chimiques. De plus, une trop grande homogénéité entraîne une vulnérabilité accrue de la culture aux maladies et aux différents ravageurs, entraînant les agriculteurs dans une escalade du recours aux produits phytosanitaires. Les variétés sélectionnées et commercialisées actuellement par les semenciers ont pour objectif de produire en quantité, copieusement additionnées pour pouvoir pousser d’engrais et de pesticides, au détriment d’un intérêt nutritionnel pour le consommateur ou d’une capacité à pousser de façon plus autonome sans intrants chimiques.
Un modèle basé sur le court terme
Deuxième élément avec les études dites « technico-économiques » réalisés par les instituts techniques et les chambres d’agriculture. Là encore, les seuls éléments pris en compte dans le comparatif d’une méthode de fertilisation et de l’utilisation de pesticides, ou d’un type de pratique agricole sont les éléments financiers (coûts d’achat, investissements) ramenés à un rendement auquel est adossé un prix de vente. Aucune modulation n’est effectuée sur le coût environnemental des procédés ou encore le prix à payer pour la santé du consommateur. On peut illustrer ce principe pour comparer un modèle dit « conventionnel » à un modèle agroécologique. Si l’on se base sur les critères actuellement utilisés, l’agriculture industrielle peut être performante. Si l’on fait entrer en compte le respect de la planète, la qualité des productions et la santé des consommateurs, le modèle agroécologique est le seul viable économiquement, sanitairement et environnementalement parlant.
Quand manger nous rend malades
Malgré la surabondance de l’offre alimentaire en France, on assiste depuis une vingtaine d’années à une explosion des problèmes de santé dont l’origine se trouve dans nos assiettes. De nombreuses maladies dites de civilisation, comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires et certains cancers sont la conséquence directe d’une altération qualitative et quantitative de notre façon de nous nourrir. Les messages santé diffusés en boucle nous rabâchent les sempiternels « 5 fruits et légumes par jour ». Encore et toujours du quantitatif. Or il y a fruit et fruit. En 50 ans, une pomme a perdu 2/3 de sa richesse en vitamine C. Elle a aussi fortement accru sa quantité en résidus de pesticides. Alors manger beaucoup de fruits et de légumes, d’accord, mais encore faut-il pouvoir être sûr de leur qualité. Quid de recherches pour remettre au goût du jour des variétés riches en magnésium, en acides gras essentiels, en anti-oxydants, en vitamines ?
Le marché des compléments alimentaires ne s’est jamais aussi bien porté. Même les personnes qui mangent « bien », varié, équilibré, sont aujourd’hui subcarencées en certains nutriments. Alors, plutôt que de travailler sur des sélections de variétés agricoles plus riches nutritionnellement parlant, on continue à payer une misère nos agriculteurs pour cultiver ces variétés sans intérêts alimentaires pour ensuite payer une fortune des pilules pour compenser les carences induites par ce système.
La solution est pourtant simple : relancer la recherche publique et indépendante vers des aliments aux profils nutritionnels plus qualitatifs et vers des modes de production permettant aux plantes et aux animaux de pouvoir exprimer pleinement leur potentiel en nutriments, ce qui permettraient aux consommateurs en bout de chaîne d’être en meilleure santé.
 La planète, enjeu majeur
La planète, enjeu majeur
Dernier point fondamental également, la préservation de notre environnement. Le modèle actuel entraîne à court terme des problématiques majeures (pollutions des sols et des nappes phréatiques, appauvrissement dramatique de la biodiversité, gaspillage de la ressource eau, consommation excessive de produits pétroliers, réchauffement climatique…). Or toutes ces conséquences nous frapperont de plein fouet dans quelques années, mettant en péril notre capacité à nous nourrir et, simplement, à vivre.
Or, une fois de plus, le coût environnemental des modes de production n’est pas pris en compte. Aucune plus-value économique significative n’existe pour les paysans faisant le choix d’un modèle respectueux du vivant et de notre avenir. Les lobbyings maintiennent qu’il est impossible de produire sans recours aux pesticides. Il n’en est rien. On peut aujourd’hui à la fois assurer la quantité et la qualité des productions, en préservant la planète, la ressource eau, la biodiversité et en luttant contre le réchauffement climatique.



 La planète, enjeu majeur
La planète, enjeu majeur